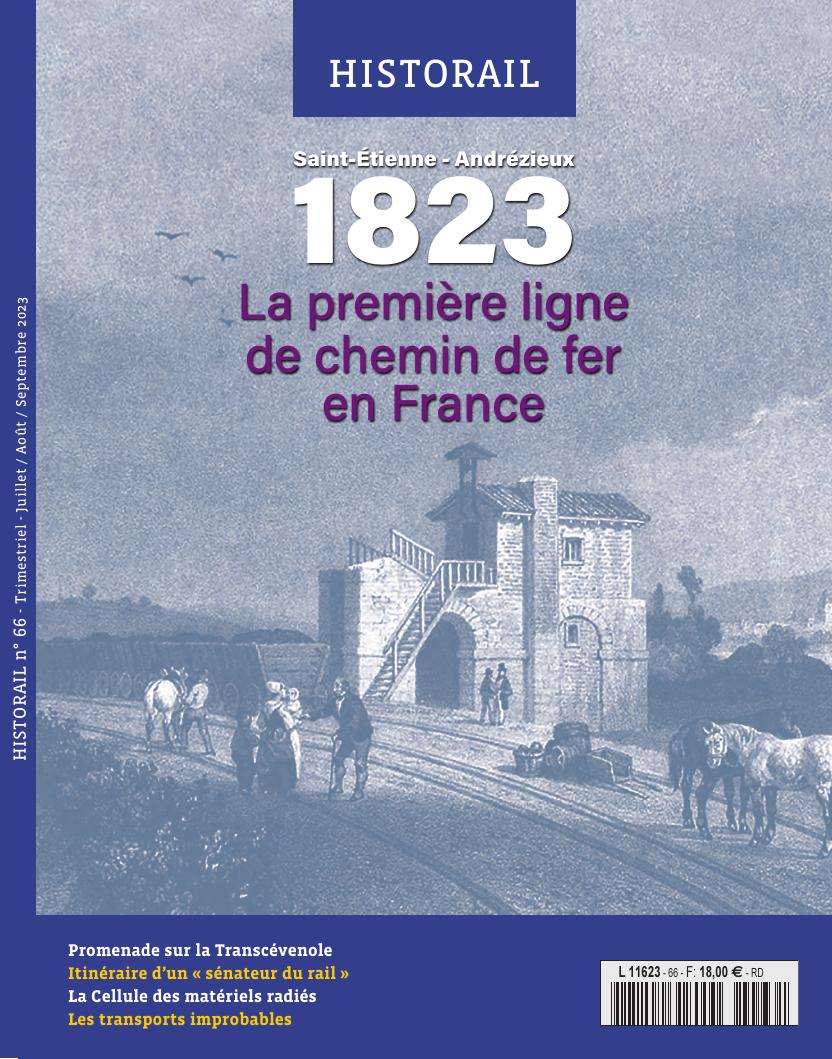Avant de choisir le rail dans sa version la plus courante, d’autres modes de transports plus ou moins fantaisistes ont parfois été envisagés. Ces véhicules ont pu être testés et même parfois construits, avant d’être finalement abandonnés.
P ourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Cet adage s’applique malheureusement parfaitement au domaine des transports où l’innovation a souvent la préférence des élus. Si l’entreprise est louable, elle a aussi conduit à envisager des engins et autres bidules totalement farfelus ou inadaptés à leur mission, au seul prétexte de la modernité. Le danger est réel, alors que les systèmes de transports performants sont toujours plus chers, longs à construire, et souvent peu rentables. Financées avec de l’argent public, les conséquences d’un ratage se reportent lourdement sur la collectivité. Il suffit pour s’en convaincre de se pencher sur quelques projets, où l’on est souvent passé très près de la catastrophe, quand on n’a carrément pas su l’éviter.
Et le phénomène n’est malheureusement pas nouveau. À Paris, à la fin du XIXe siècle, avant que l’État n’accorde à la ville le droit de construire son métro, de nombreux ingénieurs et autres hurluberlus ont élaboré des plans pour desservir la capitale. L’un d’eux, se pensant visionnaire, proposa une solution pour améliorer le système de traction. Aussi simple qu’inutile, son train avance sans énergie en… dévalant une pente en roue libre jusqu’à la station suivante. Génial ? Pas tant que ça, puisque la rame, ou plutôt la voiture, une fois arrivée, doit emprunter un ascenseur pour se replacer au sommet de la pente. À chaque station donc, la voiture attend qu’un monte‑charge la hisse à une hauteur suffisante qui lui permette de dévaler sans efforts. Ce « génial inventeur » n’avait aucune idée de ce que pouvait être un transport de masse. Comment aurait-il pu imaginer une ligne accueillant près de 800 000 voyageurs par jour comme le font aujourd’hui les 1 et 4, les plus chargés du réseau. Même dans ses pires cauchemars, il n’avait pas envisagé la cohue des heures de pointe, les surcharges de la ligne 13 ou encore ces rames de 120 m qui se succèdent à la fréquence de 80 secondes sur la 14. Ce « visionnaire » ne l’était au final pas tant que cela… Le manque de clairvoyance est bien souvent à la base de nombreux projets de systèmes de transport. Aveuglés par l’innovation, leurs concepteurs en oublient les aspects pratiques de mise en oeuvre et l’adéquation des moyens au problème à résoudre. Ce n’est donc plus au système de transport de s’adapter, mais au besoin de mobilité de se rendre compatible avec la solution déployée. À ce jeu-là, on écrase une fourmi avec une bombe atomique, et c’est précisément ce qui a failli se produire pour la desserte de la ville nouvelle de Cergy.